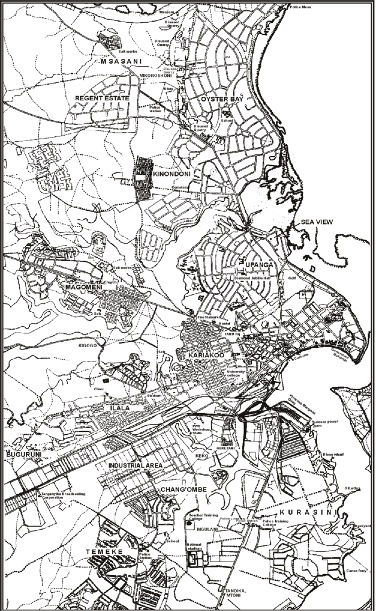Ce n’était presque rien, une marque de famille. Juste un peu plus développée chez moi, plus fournie, au sens propre, que chez les autres femmes de notre lignée.
Ma grand-mère adorait les fourrures. Elle en possédait plusieurs, sous forme de manteaux, de capes, de manchon, de bonnet ou d’étole. L’été, elles étaient remisées dans de grandes poches de plastique que l’on suspendait à un cintre. Une armoire entière y était consacrée. En hiver, elle ne sortait jamais sans l’une d’elles, la zibeline ou le phoque, le vison ou le ragondin. A l’intérieur, elle portait une étole qui ne la quittait pas, un renard dont le museau pointu et les yeux de verre qui nous fixaient par-dessus son épaule, me fascinaient. Lorsque j’embrassais ma grand-mère sur la joue, je choisissais, contrairement à mes cousins et cousines, effrayés, le côté du renard. J’aurais voulu, au lieu d’effleurer la joue parcheminée, poser mes lèvres sur son pelage, entre le museau et les yeux. Un jour où l’étole était un peu de travers, je parvins, en m’y prenant habilement, à glisser de la joue de ma grand-mère vers le front du renard et à y appuyer très brièvement mes lèvres. Le souvenir de ce contact se fixa en moi de manière indélébile et, je dois l’avouer, un peu effrayante, car la fourrure était étrangement tiède. Par la suite, chaque fois que je m’approchais de ma grand-mère, il me semblait que les yeux de verre étincelaient à mon approche.
Les fourrures étaient des cadeaux de mon grand-père, et peut-être d’autres hommes, car ma grand-mère avait eu une vie aventureuse, c’est du moins ce qui se chuchotait. Sur les photos anciennes, elle était d’une beauté mystérieuse, douce et autoritaire à la fois. Je me souviens d’elle, quant à moi, simplement comme d’une vieille dame mélancolique et par moments très gaie, entièrement vouée au bonheur de ses proches – ce qui suffit à expliquer sa mélancolie et, sans doute, sa gaieté.
Peu après la mort de ma grand-mère, et déjà avant, il y eut toute cette campagne contre l’exploitation des animaux à fourrure, des mannequins célèbres se firent photographier complètement nues pour signifier qu’elles n’en porteraient plus, les fourrures disparurent des défilés de mode, ou furent remplacées par des poils synthétiques, parfois teints de couleurs vives, ou imitant parfaitement le pelage ocellé de la panthère ou l’aspect dru et ras de la peau de phoque.
J’avais alors douze ans, et il m’arriva quelque chose d’étrange, que j’avais noté avec curiosité chez mes cousines plus âgées, mais qui, chez moi, prit des proportions bien plus visibles.º Surtout que, chez moi, cela ne se manifesta pas exactement au même endroit.
La renarde ! rugit ma mère un matin en m’apercevant. Encore mal réveillée, j’étais en train de me diriger vers la salle de bain pour la toilette matinale. Peu habituée à ce genre d’expression dans la bouche maternelle, plus apte aux marmonnements pieux et aux recommandations frileuses, et plutôt parcimonieuse en exclamations, je sursautai et lui jetai un regard où devait se lire mon ahurissement. Mais ma mère avait déjà détourné les yeux, et il me semblât que quelque chose dans son mouvement trahissait une gêne étrange. J’ouvris la porte, au bout du couloir, la refermai derrière moi, sans tour de clé, puisque cela nous était interdit. En me retournant j’eus un des spectacles les plus saisissants qu’il m’ait été donné de voir. Je ne pus retenir un petit cri. Horreur et stupéfaction. Dans le miroir, apparaissait bien la fille que je croyais connaître, frêle dans sa longue chemise de nuit, les cheveux emmêlés et les yeux encore bouffis de sommeil. Au centre du visage, cependant, une anomalie avait fait son apparition, flagrante.
C’était la première fois que je voyais la marque. Je dis la première fois parce que, par la suite, il m’a semblé clair qu’elle ne pouvait être apparue d’un seul coup cette nuit-là, comme par enchantement, et qu’elle devait s’être développée petit à petit, sans que j’y prenne garde, jusqu’à ce matin fatidique où il m’était devenu impossible de ne pas la remarquer. Partant de la pointe du nez et remontant jusqu’à s’évaser entre les sourcils, un long et mince V s’était dessiné, à la manière des tiges légèrement courbes des motifs végétaux de l’art nouveau.
Plus tard, en découvrant l’étrange pouvoir que me procurerait cette particularité, j’allais apprendre à la chérir, mais au moment où je la découvrais, stupéfaite, dans le miroir de la salle de bain familiale, une sombre panique commença d’abord par me gagner. Mon premier réflexe, malgré la consigne sévère, fut de donner un tour de clé à la porte, soudain terrifiée à l’idée qu’une de mes sœurs ou mon frère me surprenne, porteuse de cette honteuse – pensai-je – difformité. Ensuite, je m’approchai de la glace, pressée d’examiner de plus près l’étrangeté, avec le sourd pressentiment que son caractère indéniable allait du même coup m’être confirmé. En effet, ni tache lavable, ni simple empreinte que la journée aurait tôt fait de lisser, le V était en fait formé de fins poils foncés. Au toucher, et à la manière douce qu’avait la lumière d’y jouer, je réalisai que le duvet était aussi irrésistiblement soyeux. Cette constatation me mit un peu de baume au cœur. L’air songeur, j’étais en train de me passer et repasser doucement le doigt du bout du nez au centre des sourcils, quand tout à coup quelqu’un frappa à la porte.
De manière générale, les réactions à cette transformation ne furent pas celles que j’aurais escomptées. Je m’étais attendu, malgré l’atmosphère tout en retenue qui régnait chez nous, à des visages surpris, à quelques exclamations, à des questions. A tout le moins, à un semblant d’inquiétude. Au lieu de cela, ce ne furent que regards fuyants, expressions pudiques ou faussement neutres. Ou bien, chez mon frère Paul par exemple, légèrement teintées d’une connivence dont je ne comprenais pas l’objet et qui ne faisait que renforcer mon malaise. A part ma jeune sœur, Claire, que ma mère eut tôt fait de rabrouer lorsqu’elle ouvrit la bouche en faisant mine de s’intéresser à mon nouvel attribut, personne ne s’autorisa le moindre commentaire. Il semblât qu’un accord tacite eut été passé entre les membres aînés de la famille pour éviter d’évoquer l’étrange marque qui était venue modifier mon apparence. Tout se passait comme s’il s’agissait d’une métamorphose attendue et tout à fait normale, mais en même temps vaguement honteuse et qu’il valait mieux ignorer.
Mon sommeil se troubla. Je ne cessais de rêver de la marque ; j’assistais à des défilés de femmes nues, aux corps partiellement couverts de toisons moirées, fourrures naturelles qui marquaient leur peau de signes cabalistiques ; je la voyais apparaître sur le visage de ma sœur aînée ou de ma mère, mais elles y semblaient totalement indifférentes, hautaines et sérieuses comme elles l’étaient toujours, préoccupées uniquement du devoir à accomplir et de ce qu’il fallait paraître. C’était en réalité un trait commun chez les femmes de ma famille, ce sens de la responsabilité et du dévouement, allié à une réserve tout en modestie et en rigueur, qui les faisait passer pour des saintes dans l’opinion générale. Mon père, lui, était un homme autoritaire et, en règle générale, plutôt absent de la cellule familiale, où il ne se manifestait que pour rappeler certains principes moraux inébranlables, notamment à mon frère, le plus rétif de la tribu.
Paul avait toujours été le mouton noir de la fratrie et, secrètement, je l’enviais d’oser défier l’autorité parentale pour goûter à des plaisirs interdits. Mais il était également spécialement doué pour amadouer ma mère, par une douceur pleine de rouerie et de tendresse. Il ressemblait à ma grand-mère, disait-on, et cela semblait suffire à excuser son caractère plus expressif et à engendrer une plus grande tolérance face à ses sautes d’humeur et à ses incartades.
Ce matin-là, ce fut lui qui interrompit mon insondable songerie et le questionnement qui me bousculait, alors que, debout dans ma chemise de nuit devant le miroir, je ne me lassais pas d’admirer, dans un mélange de fascination et de répulsion, la marque nouvellement apparue. D’une voix étranglée, je répondis à Paul, qui insistait derrière la porte et s’étonnait que je l’eusse fermée à clé. J’arrivais, il fallait me laisser encore quelques minutes. Lorsque je l’entrouvris timidement, un instant plus tard, espérant avoir le champ libre, je le trouvai debout, l’air railleur, qui m’attendait. Alors, on a ses premières ragnagnas ou quoi ? Et il enchaîna presque immédiatement, en m’attrapant le poignet alors que j’essayais de l’esquiver. Tiens, tiens, tu cherches à cacher quelque chose ? Que vois-je… ? Mais, on dirait que ça pousse ! Voilà qui va en intéresser plus d’un… Je me dégageai d’un coup sec, sans attendre mon reste. Il cria encore quelque chose, où il était question de notre cousine, Marthe. Celle qui avait mal tourné suite à la croissance, affirmaient toujours les adultes à mi-voix. Je courus m’enfermer dans le petit coin, comme on disait pudiquement chez nous, le seul endroit où je puisse être seule et tranquille, pour reprendre mon souffle. Assise sur la cuvette, je pensais confusément à mes cousines, Marthe que je n’avais vue qu’une fois, et les autres, dont les tantes disaient d’un air entendu qu’elles étaient des jeunes filles désormais, et j’entendais encore mon frère affirmant qu’elles avaient des poils sous les bras, et je voyais leurs jeunes seins, pointant sous leur strictes robes en coton gris.
L’été de mes douze ans s’acheva dans ce mélange de confusion et de malaise. J’avais l’humeur changeante, j’étais farouche et à la fois affamée d’attention. Et je pensais souvent à la phrase proférée par mon frère. Voilà qui va en intéresser plus d’un… Je me répétais ces mots comme s’ils possédaient un sens secret qu’il me fallait découvrir à tout prix, la clé de l’énigme et l’accès à un savoir qui m’échappait. Le duvet qui couvrait mon visage s’était légèrement affirmé, j’avais alors l’arête du nez totalement recouverte d’un pelage soyeux, que je ne pouvais m’empêcher de lisser de temps à autre, quand on ne me regardait pas, avec une sorte de délectation. Ce contact me causait un léger vertige, très agréable, au creux du ventre. Ce plaisir se teintait rapidement de honte, il suffisait que l’ombre de ma mère ou que la figure de mon père planât et je tremblais à l’idée d’être percée à jour. Un après-midi caniculaire, à la fin du mois d’août, je pris le sentier qui s’enfonçait sous les frondaisons, à l’arrière de la maison, en quête d’un peu de fraîcheur et de solitude. Cette promenade, qui menait à un petit bois à la lisière du bourg où nous vivions, nous était totalement interdite avant nos douze ans, âge auquel mes parents avaient décidé que nous étions enfin assez mûrs pour nous éloigner du jardin, en restant bien entendu dans un périmètre bien défini. J’avais toutefois reçu la consigne claire de ne pas m’y aventurer seule, mais uniquement accompagnée d’un de mes aînés.
Ce jour-là, pourtant, je décidai de défier l’ordre parental, échauffée et vibrante de sensations confuses, prête à toutes les audaces. Sur le chemin, je m’étais laissée aller à cette excitation latente, à cette douce fébrilité qui m’exaltait. Je ne portais qu’une robe d’été légère, démodée et sans doute déjà un peu étroite pour ma taille. Ma mère nous avait toujours habillés avec des vêtements de récupération, fonctionnels et décents, refusant toute futilité et toute dépense qu’elle jugeait inutile. Arrivée dans la clairière centrale, au bout du sentier, je m’assis par terre, le dos contre un tronc. Je remontai le bas de ma robe au-dessus des genoux et baissai les bretelles sur mes épaules, gênée par le tissu rêche contre ma peau moite. Très vite, je perçus sa présence. Il me semblât d’abord qu’un souffle léger avait froissé le feuillage, à quelques mètres de moi. Ensuite, en y fixant mon attention, je crus voir deux yeux briller, entre les branchages feuillus. Un pas furtif se fit entendre. On contournait l’arbre contre lequel j’étais appuyée. J’haletais. Il faisait chaud, j’avais l’impression que chaque centimètre carré de ma peau frémissait, assoiffé. Je sentis la présence toute proche, juste derrière moi. Un infime courant d’air m’atteignit. Je frissonnais, fermai les paupières. Et tout à coup, je ressentis comme une caresse à l’endroit de la marque, une sensation infiniment douce et agréable, qui allait en s’intensifiant. A tel point que lorsque je cherchai à rouvrir mes yeux, je ne pus plus distinguer le sous-bois autour de moi, tout se brouillait. Je m’entendis gémir, je perdis pied, mon corps entier tremblait, des larmes ou de la sueur me coulait sur les tempes, je ne fus bientôt plus qu’une sensation croissante, qui partait du museau et rayonnait dans mes bras, mon ventre, mes cuisses, mes orteils, de plus en plus forte, jusqu’à la brûlure. Je poussai un cri et quelque chose en moi se liquéfia. Je fus submergée. Je sombrai dans un état d’assoupissement béat, entre veille et sommeil, acuité des sens et relâchement total.
Quand j’en sortis, j’étais couchée dans le sous-bois, les épaules et les mollets couverts d’empreintes d’aiguilles de pin et les cheveux emmêlés. En me relevant, je crus apercevoir un regard étincelant entre les branches d’un buisson. Il faisait déjà sombre. Je me hâtais sur le chemin du retour, sans me soucier des réprimandes et du ton aigre qui m’accueilleraient à la maison, le front haut, remplie d’une félicité nouvelle.
º Le passage en italique est un texte de Caroline Lamarche proposé lors d’un concours qui a eu lieu en 2010, intitulé « Achève-moi ». Les participants étaient invités à inventer la suite d’un des textes proposés, au choix. Je m’étais prêtée au jeu.
Partager, imprimer ou envoyer ce texte.